| |
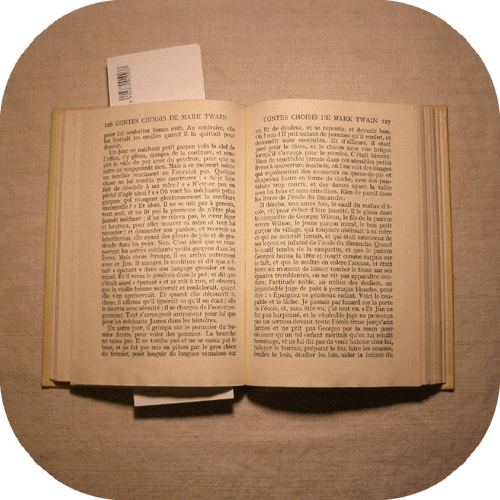
Morceaux choisis de :
|
|
|
|
Lecture en ligne
Sur cette page, je propose de la lecture en ligne. Choisissez dans le menu de gauche l'auteur dont vous voulez lire un morceau choisi. Chaque morceau choisi est un texte intégral d'une oeuvre littéraire.
Morceaux choisis
|

Mark Twain
Nuit sans sommeil, un conte humoristique de Mark Twain (1835-1910).
|
Nuit sans sommeil
Texte traduit de l'anglais par Gabriel de Lautrec
Nous fûmes au lit à dix heures, car nous devions nous lever au petit jour pour continuer notre route vers chez nous. J'étais un peu énervé, mais Harris s'endormit tout de suite. Il y a dans cet acte un je ne sais quoi qui n'est pas exactement une insulte et qui est pourtant une insolence, et une insolence pénible à souffrir. Mais plus j'essayais, plus je m'éveillais. J'en vins à méditer tristement dans l'obscurité, sans autre compagnie qu'un dîner mal digéré. Mon esprit partit, peu à peu, et aborda le début de tous les sujets sur lesquels on ait jamais réfléchi. Mais sans aller jamais plus loin que le début. C'était toucher et partir. Il volait de pensée en pensée avec une prodigieuse rapidité. Au bout d'une heure ma tête était un parfait tourbillon. J'étais épuisé, fatigué à mort.
La fatigue devint si grande qu'elle commença à lutter avec l'excitation nerveuse. Tandis que je me croyais encore éveillé, je m'assoupissais en réalité dans une inconscience momentanée, d'où j'étais violemment tiré par une secousse qui rompait presque mes articulations, l'impression du moment étant que je tombais dans quelque précipice. Après avoir dégringolé dans huit ou neuf précipices, et m'être ainsi aperçu que la moitié de mon cerveau s'était éveillée à plusieurs reprises, tandis que l'autre moitié dormait, soupçonnée de la première qui luttait pour résister, l'assoupissement complet commença à étendre son influence graduelle sur une plus grande partie de mon territoire cérébral, et je tombai dans une somnolence qui devint de plus en plus profonde, et qui était sans doute sur le point de se transformer en solide et bienfaisante stupeur, pleine de rêves, quand
Qu'y avait-il donc ?
Mes facultés obscurcies furent en partie ramenées vers la conscience, et prirent une attitude réceptive. Là-bas, d'une distance immense, illimitée, venait quelque chose qui grandissait, grandissait, approchait, et qu'on put bientôt reconnaître pour un son. Au début, cela ressemblait plutôt à un sentiment. Ce bruit était à un kilomètre, maintenant. Peut-être le murmure d'une tempête. Puis, il s'approchait. Il n'était pas à un quart de mille. Etait-ce le grincement étouffé d'une machine lointaine ? Non. Le bruit s'approchait, plus près encore, plus près, et à la fin il fut dans la chambre même. C'était simplement une souris en train de grignoter la boiserie. Ainsi c'était pour cette bagatelle que j'avais si longtemps retenu ma respiration !
Bien. C'était une chose faite. Il n'y avait pas à y revenir. J'allais m'endormir tout de suite et réparer le temps perdu. Vaine pensée ! Sans le vouloir, sans presque m'en douter, je me mis à écouter le bruit attentivement et même à compter machinalement les grincements de la râpe à muscade de la souris. Bientôt, cette occupation me causa une souffrance raffinée. Cependant j'aurais peut-être supporté cette impression pénible, si la souris avait continué son uvre sans interruption. Mais non. Elle s'arrêtait à chaque instant. Et je souffrais bien plus en écoutant et attendant qu'elle reprît que pendant qu'elle était en train. Au bout de quelque temps, j'aurais payé une rançon de cinq, six, sept, dix dollars, pour être délivré de cette torture. Et à la fin j'offrais de payer des sommes tout à fait en disproportion avec ma fortune. Je rabattis mes oreilles, c'est-à-dire je ramenai les pavillons, et les roulai en cinq ou six plis, et les pressai sur le conduit auditif, mais sans résultat. Mon ouïe était si affinée par l'énervement que j'avais comme un microphone et pouvais entendre à travers les plis sans difficulté.
Mon angoisse devenait de la frénésie. A la fin, je fis ce que tout le monde a fait, depuis Adam, en pareil cas. Je décidai de jeter quelque chose. Je cherchai au bas du lit, et trouvai mes souliers de marche, puis je m'assis dans le lit, et attendis, afin de situer le bruit exactement. Je ne pus y parvenir. Il était aussi peu situable qu'un cri de grillon. On croit toujours qu'il est là où il n'est pas. Je lançai donc un soulier au hasard, avec une vigueur sournoise. Le soulier frappa le mur au-dessus du lit l'Harris et tomba sur lui. Je ne pouvais pas supposer qu'il irait si loin. Harris s'éveilla, et je m'en réjouis, jusqu'au moment où je m'aperçus qu'il n'était pas en colère. Alors je fus désolé. Il se rendormit rapidement, ce qui me fit plaisir. Mais aussitôt le grignotement recommença, ce qui renouvela ma fureur. Je ne voulais pas éveiller de nouveau Harris, mais le bruit continuant me contraignit à lancer l'autre soulier. Cette fois, je brisai un miroir ; il y en avait deux dans la chambre. Je choisis le plus grand, naturellement. Harris s'éveilla encore, mais n'eut aucune plainte, et je fus plus triste qu'avant. Je me résolus à subir toutes les tortures humaines plutôt que de l'éveiller une troisième fois.
La souris pourtant s'éloigna, et peu à peu je m'assoupissais, quand une horloge commença à sonner. Je comptai tous les coups, et j'allais me rendormir quand une autre horloge sonna. Je comptai. Alors les deux anges du grand carillon de l'hôtel de ville se mirent à lancer de leurs longues trompettes des sons riches et mélodieux. Je n'avais jamais ouï de notes plus magiques, plus mystérieuses, plus suaves. Mais quand ils se mirent à sonner les quarts d'heure, je trouvai la chose exagérée. Chaque fois que je m'assoupissais un moment, un nouveau bruit m'éveillait. Chaque fois que je m'éveillais, je faisait glisser la couverture, et j'avais à me pencher jusqu'au sol pour la rattraper.
A la fin, tout espoir de sommeil s'enfuit. Je dus reconnaître que j'étais décidément et désespérément éveillé. Tout à fait éveillé, et en outre j'étais fiévreux et j'avais soif. Après être resté là à me tourner et me retourner aussi longtemps que je pus, il me vint l'idée excellente de me lever, de m'habiller, de sortir sur la grande place pour prendre un bain rafraîchissant dans le bassin de la fontaine, et attendre le matin en fumant et en rêvant.
Je pensais pouvoir m'habiller dans l'obscurité sans éveiller Harris. J'avais exilé mes souliers au pays de la souris, mais les pantoufles suffisaient, pour une nuit d'été. Je me levai donc doucement, et je trouvai graduellement tous mes effets, sauf un de mes bas. Je ne pouvais tomber sur sa trace, malgré tous mes efforts. Il me le fallait, cependant. Je me mis donc à quatre pattes et m'avançai à tâtons, une pantoufle au pied, l'autre dans la main, scrutant le plancher, mais sans résultat. J'élargis le cercle de mon excursion et continuai à chercher en tâtonnant. A chaque fois que se posait mon genou, comme le plancher craquait ! Et quand je me heurtais au passage contre quelque objet, il me semblait que le bruit était trente-cinq ou trente-six fois plus fort qu'en plein jour. Dans ce cas-là, je m'arrêtais et retenais ma respiration pour m'assurer qu'Harris ne s'était pas éveillé, puis je continuais à ramper. J'avançais de côté et d'autre, sans pouvoir trouver le bas. Je ne rencontrais absolument pas autre chose que des meubles. Je n'aurais jamais supposé qu'il y eût tant de meubles dans la chambre au moment où je vins me coucher. Mais il en grouillait partout maintenant, spécialement des chaises. Il y avait des chaises à tous les endroits. Deux ou trois familles avaient-elles emménagé, dans l'intervalle ? Et jamais je ne découvrais une de ces chaises à temps, mais je les frappais toujours en plein et carrément de la tête. Mon irritation grandissait, et tout en rampant de côté et d'autre, je commençais à faire à voix basse d'inconvenantes réflexions.
Finalement, dans un violent accès de fureur, je décidai de sortir avec un seul bas. Je me levai donc et me dirigeai, à ce que je pensais, vers la porte, et soudain je vis devant moi mon image obscure et spectrale dans la glace que je n'avais pas brisée. Cette vue m'arrêta la respiration un moment. Elle me prouva aussi que j'étais perdu et ne soupçonnais pas où je pouvais être. Cette pensée me chagrina tellement que je dus m'asseoir sur le plancher et saisir quelque chose pour éviter de faire éclater le plafond sous l'explosion de mes sentiments. S'il n'y avait eu qu'un miroir, peut-être aurait-il pu me servir à m'orienter. Mais il y en avait deux, et c'était comme s'il y en avait eu mille. D'ailleurs, ils étaient placés sur les deux murs opposés. J'apercevais confusément la lueur des fenêtres, mais dans la situation résultant de mes tours et détours, elles se trouvaient exactement là où elles n'auraient pas dû être, et ne servaient donc qu'à me troubler au lieu de m'aider à me retrouver.
Je fis un mouvement pour le lever, et je fis tomber un parapluie. Il heurta le plancher, dur, lisse, nu, avec le bruit d'un coup de pistolet. Je grinçai des dents et retins ma respiration. Harris ne remua pas. Je relevai doucement le parapluie et le posai avec précaution contre le mur. Mais à peine eus-je retiré la main que son talon glissa sous lui et qu'il tomba avec un autre bruit violent. Je me recroquevillai et j'attendis un moment, dans une rage muette. Pas de mal. Tout était tranquille. Avec le soin le plus scrupuleux et le plus habile, je redressai le parapluie une fois de plus, retirai la main
et il tomba de nouveau.
J'ai reçu une éducation excellente, mais si la chambre n'avait pas été plongée dans une sombre, solennelle et effrayante tranquillité, j'aurais sûrement proféré une de ces paroles qu'on n'eût pu mettre dans un livre de l'école du dimanche sans en compromettre la vente. Si mes facultés mentales n'avaient été depuis longtemps réduites à néant par l'épuisement où je me trouvais, je n'aurais pas essayé une minute de faire tenir un parapluie debout, dans l'obscurité, sur un de ces parquets allemands, polis comme une glace. En plein jour, on échouerait une fois sur cinq. J'avais une consolation, pourtant : Harris demeurait calme et silencieux. Il n'avait pas bronché.
Le parapluie ne pouvait me donner aucune indication locale. Il y en avait quatre dans la chambre, et tous pareils. Je pensai qu'il serait pratique de suivre le mur, en essayant de trouver la porte. Je me levai pour commencer mon expérience, et je décrochai un tableau. Ce n'était pas un grand tableau, mais il fit plus de bruit qu'un panorama. Harris ne bougea pas : mais je compris qu'une autre tentative picturale l'éveillerait sûrement. Il valait mieux renoncer à sortir. Le mieux était de trouver au milieu de la chambre la table ronde du roi Arthur je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois et de m'en servir comme point de départ pour une exploration vers mon lit. Si je pouvais atteindre mon lit, je retrouverais mon pot à eau, je calmerais ma soif dévorante et me coucherais. Je repartis donc à quatre pattes. J'allais plus vite de cette façon et aussi plus sûrement, sans risquer de rien renverser. Au bout d'un moment, je trouvai la table, avec ma tête, me frottai un peu le front, puis me levai et partis, les mais allongées et les doigts écartés, pour tenir mon équilibre. Je trouvai une chaise, puis le mur, puis une autre chaise, puis un sofa, puis un alpenstock, puis un autre sofa. Cela me troubla, car je pensais qu'il n'y avait qu'un sofa dans la chambre. Je regagnai la table pour m'orienter et repartir. Je trouvai quelques chaises de plus.
Il arriva maintenant, comme sans doute il était arrivé tout à l'heure, que la table, étant ronde, n'était d'aucune valeur comme base pour un départ d'exploration. Je l'abandonnai donc une fois de plus, et m'en allai au hasard à travers la solitude des chaises et des sofas. J'errai dans des pays inconnus, et fis tomber un flambeau de la cheminée. En cherchant le flambeau, je renversai un pot à eau, qui fit un fracas terrible, et je me dis en moi-même : « Vous voilà enfin. Je pensais bien que vous étiez par là. » Harris cria : « Au meurtre ! Au voleur ! » et ajouta : « Je suis absolument trempé. » C'était l'autre pot à eau.
Le bruit avait réveillé toute la maison. Monsieur X
entre précipitamment dans son long vêtement de nuit, tenant un bougeoir. Le jeune Z
après lui, avec un autre bougeoir. Une procession par une autre porte avec des flambeaux et des lanternes, l'hôte et deux voyageurs allemands, en robes de chambre, ainsi qu'une femme, de chambre aussi.
Je regardai. J'étais auprès du lit de Harris, à un jour de voyage du mien. Il n'y avait qu'un sofa. Il était contre le mur. Il n'y avait qu'une chaise à ma portée. J'avais tourné autour d'elle comme une comète, la heurtant comme un météorite la moitié de la nuit.
J'expliquai ce qui m'était arrivé, et pourquoi cela était arrivé ; les gens de la maison se retirèrent et nous nous occupâmes de déjeuner, car l'aurore pointait déjà. Je jetai un coup d'il furtif sur mon podomètre, et trouvai que j'avais parcouru quarante-sept milles. Mais peu importait, puisque, après tout, je voulais sortir faire un tour.
Mark Twain
Retour au menu
|

Rudyard Kipling
Tu seras un Homme mon fils, poème de Rudyard Kipling (1865-1936).
|
Tu seras un Homme mon fils
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou, perdre d'un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre
Et, te sentant haï sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle,
Sans mentir toi-même d'un seul mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n'être qu'un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors, les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un Homme, mon fils.
Rudyard Kipling
Retour au menu
|

Georges Duhamel
Les trois arbres, petite fable en prose de Georges Duhamel (1884-1966), extraite de son livre Fables de mon jardin, paru en 1936 aux éditions du Mercure de France.
|
Les trois arbres
Les arbres nouveaux devisaient à mi-voix, sous le hangar, en attendant qu'on les plantât.
Moi, disait un jeune cerisier, je fleuris toujours de bonne heure. Ce n'est pas pour me distinguer. Non, je vous assure : je suis la modestie même. Je fleuris de bonne heure parce que c'est une tradition dans ma noble famille
Les fruits que nous donnons dans la famille sont renommés de tout l'univers. Pensez : le bigarreau ! Nous faisons le bigarreau blanc. Et vous, Monsieur mon voisin.
Moi, répondit le voisin d'un ton revêche, moi c'est la poire.
Vraiment, la poire ! C'est très intéressant. Vous n'avez pas de noyau, paraît-il ?
Dieu merci, non ! Mais des pépins, et plus que je n'en voudrais. De la poire, j'en donne, au besoin, à condition, bien entendu, qu'on ne me tourmente pas. S'ils me laissent tranquille, ici, je ferai peut-être une ou deux poires. S'ils me taillent, s'ils me tripotent, alors bernique.
Ah ! Oui. C'est très intéressant. Et vous, le petit, là-bas ?
Plaît-il ?
Oui, vous ! Qu'est-ce que vous faites ?
L'arbre ainsi mis sur la sellette était un petit pommier tout rabougri, tout chétif.
Oh ! répondit-il à voix basse, moi, je fais ce que je peux.
Les arbres furent plantés en terre. Dès la première année, le cerisier montra ses belles fleurs et donna quatre ou cinq cerises. Le poirier ne donna rien. Le pommier, qu'on avait placé dans un coin transi d'ombre et de courants d'air, nous offrit un boisseau de pommes.
Il y a dix ans de cela. Le petit pommier dévoué continue à nous confondre par sa générosité. Le poirier tient parole : il n'a jamais donné de fruits. Le cerisier, à chaque retour de l'avril, dit à qui veut l'entendre : « Vous allez voir ce que vous allez voir ! » Et son beau feu d'artifice, régulièrement, se termine par un déjeuner de moineau.
Georges Duhamel
Retour au menu
|

Jean de La Fontaine
Le meunier, son fils et l'âne, fable en vers de Jean de La Fontaine (1621-1695).
|
Le meunier, son fils et l'âne
Dédicacé à François de Maucroix (1619-1708), fidèle ami de La Fontaine.
L 'invention des Arts étant un droit d'aînesse,
Nous devons l'Apologue à l'ancienne Grèce.
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.
La Feinte est un pays plein de terres désertes :
Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.
Je t'en veux dire un trait assez bien inventé.
Autrefois à Racan Malherbe l'a conté.
Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa Lyre,
Disciples d'Apollon, nos Maîtres pour mieux dire,
Se rencontrant un jour, tout seuls et sans témoins
(Comme ils se confiaient leurs pensers et leurs soins),
Racan commence ainsi : « Dites-moi, je vous prie,
Vous qui devez savoir les choses de la vie,
Qui par tous ses degrés avez déjà passé,
Et que rien ne doit fuir en cet âge avancé,
À quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j'y pense.
Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance :
Dois-je dans la Province établir mon séjour,
Prendre emploi dans l'Armée ? ou bien charge à la Cour ?
Tout au monde est mêlé d'amertume et de charmes :
La Guerre a ses douceurs, l'Hymen a ses alarmes.
Si je suivais mon goût, je saurais où buter ;
Mais j'ai les miens, la Cour, le Peuple à contenter. »
Malherbe là-dessus : « Contenter tout le monde !
Écouter ce récit avant que je réponde.
J'ai lu dans quelque endroit qu'un Meunier et son Fils,
L'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits,
Mais garçon de quinze ans, si j'ai bonne mémoire,
Allaient vendre leur Âne un certain jour de Foire.
Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit,
On lui lia les pieds, on vous le suspendit ;
Puis cet Homme et son Fils le portent comme un lustre ;
Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.
Le premier qui les vit de rire s'éclata.
« Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ?
Le plus Âne des trois n'est pas celui qu'on pense. »
Le Meunier à ces mots connaît son ignorance.
Il met sur pieds sa Bête, et la fait détaler.
L'Âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller,
Se plaint en son patois. Le Meunier n'en a cure.
Il fait monter son Fils, il suit, et d'aventure
Passent trois bons Marchands. Cet objet leur déplut.
Le plus vieux au Garçon s'écria tant qu'il put :
« Oh là oh ! descendez, que l'on ne vous le dise,
Jeune homme qui menez Laquais à barbe grise.
C'était à vous de suivre, au vieillard de monter.
Messieurs, dit le Meunier, il vous faut contenter. »
L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte,
Quand? trois filles passant, l'une dit : « C'est grand'honte
Qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils,
Tandis que ce nigaud, comme un Évêque assis,
Fait le veau sur son Âne, et pense être bien sage.
Il n'est, dit le Meunier, plus de Veaux à mon âge.
Passez votre chemin, la Fille, et m'en croyez. »
Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,
L'Homme crut avoir tort, et mit son Fils en croupe.
Au bout de trente pas, une troisième troupe
Trouve encore à gloser. L'un dit : « Ces gens sont fous,
Le Baudet n'en peut plus ; il mourra sous leurs coups.
Hé quoi, charger ainsi cette pauvre Bourrique !
N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?
Sans doute qu'à la Foire ils vont vendre sa peau.
Parbieu, dit le Meunier, est bien fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son Père :
Essayons toutefois, si par quelque manière
Nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux.
L'Âne, se prélassant, marche seul devant eux.
Un Quidam les rencontre, et dit : « Est-ce la mode
Que Baudet aille à l'aise, et Meunier s'incommode ?
Qui de l'Âne ou du Maître est fait pour se lasser ?
Je conseille à ces Gens de le faire enchâsser.
Ils usent leurs souliers, et conservent leur Âne.
Nicolas au rebours ; car quand il va voir Jeanne
Il monte sur sa bête, et la chanson le dit.
Beau trio de Baudets ! » Le Meunier repartit :
« Je suis Âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue ;
Mais que dorénavant on me blâme, on me loue ;
Qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien ;
J'en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien.
Quant à vous, suivez Mars, ou l'Amour, ou le Prince ;
Allez, venez, courez ; demeurez en Province ;
Prenez Femme, Abbaye, Emploi, Gouvernement :
Les Gens en parleront, n'en doutez nullement.
Jean de La Fontaine
Retour au menu
|

Léon Frapié
Le Prussien, nouvelle de Léon Frapié (1863-1949), extraite du livre L'écolière et autres contes, aux éditions Nelson, première parution en 1905.
|
Le Prussien
Tricot, ajusteur chez un fabricant du Marais, vivait seul à Paris. C'était un blond à moustaches gauloises, né dans le Calvados ; vingt-huit ans, grand, fort, placide.
Selon la destinée des gens à métier stable, il ne sortait guère d'un certain cercle limité par la rue où il habitait, par la rue où étaient son atelier et sa gargote, et par la rue où travaillait Julie, sa connaissance, qui ne pouvait se mettre en ménage, à cause d'une ribambelle de frères et surs non encore élevés.
Depuis sa libération du service militaire, toute sa vie tenait entre ces trois endroits, qu'il reliait par des stations coutumières : son marchand de tabac, sa marchande de journaux, son coiffeur, le débit avec terrasse pour l'apéritif des samedis de paie. Adapté à ce milieu, Tricot s'y mouvait comme chez lui, avec la sensation fortifiante d'être soutenu, d'être entouré favorablement.
Peu phraseur, il était cependant d'un tempérament très liant, il aimait à échanger des politesses, à reconnaître les gens, à être reconnu d'eux.
On le considérait, dans sa maison, comme un bon garçon, tranquille et régulier. Il se couchait « à des heures convenables », après avoir musardé congrûment devant la porte de l'allée en fumant une pipe, en échangeant des banalités avec les voisins, en lisant le journal où les épreuves cyclistes l'intéressaient vivement.
Les gamins réclamaient son arbitrage dans leurs jeux de rue.
M'sieu Tricot ! Il a triché !
Ah ! oui, toi, là-bas, je t'ai vu, mon farceur.
Souvent quelque commère, un marmot sur le bras, faisait des commissions tardivement ; elle apportait un seau de charbon au bas de l'escalier, ensuite elle venait poser un litre près du seau, enfin elle se plantait là, avec un pain de quatre livres, une boîte de lait, un filet plein de légumes : comment monter le tout ?
Tricot s'offrait gaiement :
Je monte le pain et le litre
tant pis si je me trompe d'étage.
On pouvait même lui demander un petit service d'argent ; les Micoin, ses voisins du quatrième étage, ne s'en faisaient pas faute.
***
Micoin, homme de peine à quatre francs par jour, était, en outre, figurant attitré à l'Ambigu, où il touchait vingt sous par représentation.
Quant il attrapa sa fluxion de poitrine, la famille, grosse de cinq enfants, dut une belle chandelle à Tricot.
Micoin ne toucherait plus rien à l'Ambigu pendant sa maladie, et sûrement on ne lui garderait pas son emploi de figurant.
Ce fut alors que Tricot sauva la situation.
Ne vous bilez donc pas tant ! Je vais aller de votre part vous remplacer, de façon qu'on ne donne pas votre emploi à un autre ; et, bien entendu, je vous rapporterai les vingt sous de chaque soir.
Le remplacement fut accepté par le chef de figuration, parce que justement, Tricot, grand et blond, aurait à représenter un Prussien.
La maladie de Micoin dura longtemps, la pièce de l'Ambigu aussi. Tricot s'en paya de jouer le Prussien pendant des semaines.
Les vingt sous rendaient un sacré service. Il ajoutait même quelque chose de sa poche, pour Lolo, son préféré : un moucheron de deux ans, pâlot, avec un cou trop long et des yeux quêteurs, clairs, impressionnants.
Tricot était épatant en Prussien ; tout le quartier allait à l'Ambigu pour le voir.
Comme ça ne pouvait manquer d'arriver, un jour, à la gargote, un copain lança la plaisanterie :
Tiens ! v'là le Prussien ! Viens donc t'asseoir à côté de moi !
Le garçon restaurateur était nouveau et, selon la nécessité de son métier, il enregistrait les clients dans sa mémoire.
Le lendemain, sans malice, il informa tout haut le copain :
Ah ! le Prussien vous a attendu ; il vient de partir.
Le copain, les habitués se tordirent aux dépens du garçon : il n'était pas long à baptiser le monde. Et, à la gargote, ce fut une nécessité, par allusion drôle à la naïveté du garçon, d'appeler Tricot, amicalement, « le Prussien ».
Tricot riait, un peu gêné, flatté dans le fond : il comprenait surtout qu'on le félicitait de rendre service aux Micoin.
La blague du garçon amusa l'atelier, la maison de Tricot, les clients du coiffeur, et naturellement, on la continuait :
Bonjour, m'sieu l'Prussien.
Messieurs, je vous annonce le Prussien.
***
Micoin se trouva guéri, précisément comme l'Ambigu changeait de spectacle ; son emploi de figurant lui fut rendu sans contestation.
Mais Tricot eut beau résigner son fameux rôle, le sobriquet de Prussien s'attacha, se répéta, tout en cessant peu à peu d'être drôle.
Le jour où un sobriquet devient indifférent, il est définitif.
Tout le monde appelait Tricot « le Prussien », sans intention, distraitement ; il répondait par habitude, sans y penser. Au bout de quelques temps, il y avait des nouveaux venus qui ignoraient complètement le nom de Tricot ; les autres l'avaient oublié.
***
Le 30 avril exactement, un dimanche, à la gargote, comme Tricot dans une discussion sur les élections prochaines, l'emportait à cause de sa voix retentissante, son adversaire se fâcha et n'inventa rien de mieux que de l'invectiver, puis de le traiter de « sale Prussien ».
Cet argument décida la majorité des habitués à se ranger contre Tricot.
Le malheur voulut qu'il y eut ballottage ; les contestations politiques se prolongèrent, s'envenimèrent. Des murmures accueillaient l'entrée de Tricot à la gargote : « Encore ce sale Prussien ! »
Et ne s'aperçut-il pas que les patrons de l'établissement, par intérêt commercial, étaient loin de le soutenir ! Pour le coup, il la trouva mauvaise :
Je change de bistro, résolut-il, on est libre avec son argent.
Alors, ce fut à croire qu'un mal couvant depuis longtemps éclatait, se généralisait fatalement.
Julie, la connaissance que Tricot rejoignait deux fois par semaine, reçut soudain cette insulte, dans une chicane entre ouvrières :
Va donc retrouver ton Prussien !
Julie fut très vexée. Elle chercha querelle à Tricot :
Pourquoi qu'on t'appelle le Prussien, aussi ?
Les quolibets des ouvrières firent qu'elle conçut une véritable animosité contre Tricot. Ils se disputèrent à chaque rencontre. Finalement, Julie provoqua la rupture et elle eut la méchanceté de lancer comme parole dernière :
Ah ! puis zut ! tu sens la choucroute !
Dans cette pénible affaire, cela frappa énormément Tricot « de sentir la choucroute ».
Troublé dans ses habitudes de gargote et de caresses, Tricot s'assombrit, devint taciturne, moins complaisant, moins endurant. Forcément l'entourage changea aussi à son égard. On disait sans aménité :
Qu'est-ce qu'il a, le Prussien, à faire la grimace ?
Alors, tous ces gens, qu'il croyait connaître intimement, dont il avait eu l'impression d'être connu en ami, Tricot sentit soudain qu'il les connaissait à peine, qu'il était à peine connu d'eux. En somme, c'était simplement une habitude de regard, une apparence ; il leur était étranger, à tous ces gens. Il fut stupéfait de trouver entre eux et lui-même si peu d'attaches, au point qu'il éprouvait des doutes : « Je ne suis pourtant pas un Prussien !
»
Le mal devait empirer.
Une fin de quinzaine, le contremaître, nommé Müller, lui rendit son livret :
Nous ne pouvons plus employer d'étrangers !
Abasourdi, Tricot protesta, cria vainement :
Mais voyons, je suis du Calvados ! Je vous montrerai mes papiers militaires.
Inutile !
Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une cabale contre vous.
Il se casa difficilement chez un autre fabricant. Une obsession le poursuivait : il se regardait dans les glaces des devantures : « J'ai donc une tête de Prussien ! »
Il arriva enfin que Julie vint le débiner dans sa maison, dans sa rue. On donnait tort à ce grand Prussien d'avoir quitté cette excellente Julie.
Une couturière du cinquième, vouée à un célibat intermittent, après avoir espéré remplacer Julie, se manifesta l'ennemie acharnée du Prussien ; par ses soins, toute la gent femelle se ligua contre lui ; les enfants, comme de juste, ne furent pas en reste d'hostilité. Dans l'escalier, on ricanait, on récriminait sur son passage :
Ce que ça sent la choucroute, ici ; on se croirait en Prusse.
Parfois, Tricot, à la dérobée, flairait sa manche.
On lui imputait maintenant de dangereuses maladies : Julie l'avait échappé belle ! Il ne fallait pas lui laisser toucher le moindre ustensile !
***
Il donna congé, plutôt que de flanquer des claques à tout ce monde-là.
Il déménagea un dimanche, avec une simple voiture à bras ; cependant il aurait eu bougrement besoin d'un coup de main, pour descendre quelques meubles assez lourds. Personne ne put, ou ne voulut se déranger.
Il comptait au moins sur Micoin, son voisin. Mais la femme entr'ouvrit la porte seulement et déclara :
Mon mari n'est pas là.
Tant bien que mal, Tricot descendit son saint-frusquin. Les gosses, en tas sur le trottoir, d'accord avec les gens aux fenêtres, blaguaient sa peine et l'empilement difficile dans la voiture.
Et puis certains objets apportés dans la rue, par un homme, à certains moments, propagent un ridicule formidable : un petit balai, un plumeau, une marmite
Un portrait de vieille femme, encadré, glissa, une sonorité de verre cassé retentit ; l'hilarité de la rue éclata en écho.
Tricot s'en fichait ; le front dur, il fumait sa pipe et lançait un jet de salive de temps en temps ; il ne daignait même pas regarder. Pourtant, sans le vouloir, parmi les gosses acharnés à le conspuer, il reconnut les Micoin ; une lassitude lui passa dans les reins, la sueur perla à son front, subitement.
Le chargement terminé, comme il était dans les brancards à arranger la bricole, les gosses bougèrent, s'avançant pour la huée du départ.
Tricot remarqua Lolo, son préféré : le moucheron pâlot, au cou trop long, avec cet air saisissant de créature qui ne veut pas mourir. Lolo campé, les yeux purs, assurés, tout droits, crachait de tout son cur :
Sale Prussien !
Alors Tricot sentit un froid, une diminution de vitalité. Il baissa le dos dans ses brancards et s'en alla sans colère, affligé, laissant quelque chose de lui-même attaché aux gosses, à la maison, emportant un reproche personnel, un dégoût, je ne sais quoi d'empoisonné, d'hostile, dans sa peau : il sentait réellement lui-même qu'il était un Prussien.
Léon Frapié
Retour au menu
|

Charles Baudelaire
Au lecteur, premier poème du recueil Les fleurs du mal de Charles Baudelaire (1821-1867), publié en 1857.
|
Au lecteur
La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.
Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.
Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.
C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.
Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d'une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.
Serré, fourmillant comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.
Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,
N'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.
Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,
Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes, ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;
C'est l'Ennui ! L'oeil chargé d'un pleur involontaire,
Il rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère !
Charles Baudelaire
Retour au menu
|

Gaston Paris
La couverture, reprise en prose par Gaston Paris (1839-1903) d'un conte en vers de Bernier, auteur français du XIIIème siècle, qui avait lui-même recueilli ce récit oral en Inde.
|
La couverture
Conte de Bernier1
Il n'y a pas bien longtemps qu'un riche habitant d'Abbeville, avec sa femme et son fils, quitta sa patrie, parce qu'il se trouvait en guerre avec des gens plus puissants que lui2, et vint s'établir à Paris. Il y fit hommage au roi et devint son bourgeois3. Bien accueilli de ses voisins dans la rue où il s'établit, il s'y livra à la marchandise4 et augmenta encore sa richesse.
Un jour arriva où Dieu lui enleva sa compagnie : il perdit la femme qui avait vécu avec lui pendant trente ans ; ils n'avaient pas eu d'autre enfant que le fils dont je vous ai parlé. Le jeune homme pleurait à côté de son père. « Mon fils, lui dit celui-ci, ne te lamente plus. Nul ne peut éviter la mort ; il faut nous résigner. Tu as devant toi des consolations. Te voilà beau5 bachelier6 et en âge de te marier. Je suis vieux, et je ne voudrais pas te laisser sans amis dans cette ville où nous sommes étrangers. Si je trouvais une femme bien née, ayant une famille honorable et nombreuse, je te la ferais volontiers épouser, et je n'épargnerais pas mes deniers7. »
Il y avait alors à Paris trois chevaliers frères, de haute naissance et fort prisés d'armes8 ; mais ils avaient engagé tous les biens, terres, bois, châteaux, pour suivre les tournois9. L'aîné avait une fille qui possédait, de par sa mère morte, une bonne maison juste en face de l'hôtel de ce prud'homme10 ; la maison rapportait bien vingt livres7 par an, sans autre peine que de recevoir l'argent ; le père n'avait pu l'engager comme le reste. Le bourgeois demanda au chevalier de lui donner sa fille en mariage pour son fils.
Les trois frères se réunirent et voulurent savoir ce qu'il donnerait au jeune homme. « J'ai, dit-il, tant en marchandises qu'en deniers, environ quinze cent livres7, que j'ai honnêtement gagnées. J'en donnerai la moitié à mon fils.
Beau sire5, répondirent les autres, nous ne pouvons nous contenter de cela. Si vous vous faisiez templier, moine noir ou moine blanc11, vous pourriez laisser votre avoir au Temple ou au couvent. Nous ne pouvons consentir dans ces conditions.
Et que demandez-vous donc ?
Nous demandons que vous cédiez absolument à votre fils tout ce que vous possédez. Si vous le voulez ainsi, le mariage sera fait, autrement non. »
Le prud'homme se mit à réfléchir, et regarda longuement son fils. « Seigneurs, dit-il enfin, j'accomplirai votre volonté. Si mon fils épouse votre fille, je lui donnerai tout ce que j'ai de vaillant sans en rien garder. »
Ainsi devant témoins il se dessaisit de tout ce qu'il possédait, en sorte qu'il n'avait pas même de quoi prendre un repas si son fils ne le lui donnait. Aussitôt le chevalier prit sa fille par la main et la mena au jeune homme, qui l'épousa peu après.
Ils vécurent ainsi en bonne paix ; bientôt la dame eut un beau fils5. Pendant douze ans le prud'homme resta dans l'hôtel, tant que le garçon eut grandi et commença à comprendre les choses. Il avait souvent entendu raconter ce que son grand-père avait fait pour son père afin qu'il épousât sa mère, et il ne l'oubliait pas.
Le prud'homme était devenu très vieux ; il ne pouvait marcher qu'avec un bâton, et il était à charge à ses enfants. La dame, surtout, ne pouvait supporter sa présence. « Sire5, dit-elle un jour à son mari, donnez congé à votre père ; je ne saurais manger si je le vois encore à la maison.
Dame5, dit-il, je le ferai puisque vous le voulez. » Il craignait sa femme, qui était fière et dure de cur.
Il vint trouver son père et lui dit : « Père, père, il faut vous en aller de céans. On vous a nourri dans cet hôtel pendant plus de douze ans ; tout a une fin : allez chercher votre vie ailleurs. »
Le père en l'entendant se mit à pleurer et à regretter d'avoir tant vécu. « Que me dis-tu là, beau5 doux fils ? Permets-moi seulement de rester dans ta cour. Je me contenterai de peu de place. Je ne te demande même pas de feu, ni de matelas ou de tapis ; fais-moi seulement jeter un peu de paille là, sous cet appentis, et donner chaque jour un peu de pain. Je n'ai guère de temps à vivre, et tu ne dois pas m'abandonner. Le bien que tu me feras est la meilleure pénitence que tu puisses faire de tes péchés.
Beau5 père, vos sermons sont inutiles. Dépêchez-vous, allez-vous en, ou ma femme perdra la raison.
Et où veux-tu que j'aille ? Je ne possède rien.
Allez par la ville ; il y en a bien d'autres qui y cherchent leur vie. Peut-être y aura-t-il des gens qui vous reconnaîtront et vous hébergeront.
Tu crois ? qui voudra m'héberger quand mon propre fils me met dehors ?
Père, je n'en puis mais. C'est moi qui fais la chose, mais vous ne savez pas si c'est de mon plein gré.
Adieu, fils, dit-il, je m'en vais puisque tu le veux. Mais j'ai un vêtement bien mince et qui ne me défendra pas du froid ; c'est ce que je redoute le plus. Donne-moi quelque chose pour me couvrir.
Je n'ai rien.
Beau5 fils, je tremble de froid. Donne-moi au moins une des couvertures dont tu couvres tes chevaux. »
Le jeune homme voit qu'il ne pourra s'en débarrasser s'il ne lui donne quelque chose. Il appelle son fils et lui dit : « Va-t'en à l'écurie et donne à ton grand-père une des couvertures de mon cheval noir. »
L'enfant dit : « Beau5 grand-père12, venez avec moi. »
Le prud'homme le suit tout affligé. L'enfant prend la couverture la plus large et la plus belle ; il la plie en deux et de son couteau il en fait deux moitiés.
« Et pourquoi, dit le vieillard, me la coupes-tu ainsi ? Ton père me l'avait donnée tout entière. Tu es plus cruel que lui. Je vais aller le lui dire.
Allez-y, fait l'enfant ; je ne vous en donnerai pas plus. »
Le vieillard revient auprès de son fils : « Tes ordres, dit-il, sont mal écoutés. Tu devrais corriger ton fils, qui ne te craint guère. Vois : il a gardé la moitié de la couverture que tu m'avais donnée.
Fils, dit le père, donne-la-lui tout entière.
Je n'en ferai rien, répond l'enfant. Qu'est-ce qui me resterait pour vous ? Je veux en garder la moitié ; c'est ce qu'un jour vous aurez de moi. Je vous traiterai comme vous l'avez traité. Vous me donnerez votre avoir comme il vous a donné le sien, et vous aurez de moi ce qu'il a de vous. »
Le père l'entend : il réfléchit et rentre en lui-même ; il soupire profondément. « Père, dit-il enfin, revenez ! C'est le diable qui m'avait surpris, mais Dieu m'a éclairé par la bouche de cet enfant. Je vous fais désormais seigneur et maître de mon hôtel. Si ma femme s'y oppose et ne vous laisse pas de repos, je trouverai une autre maison où vous serez bien honoré et servi. Je ne mangerai ni ne boirai rien que vous n'ayez aussi bien que moi ; vous porterez les mêmes vêtements que moi ; vous coucherez dans un lit moelleux, et vous pourrez, dans une belle chambre, vous asseoir près d'un bon feu de cheminée. C'est à vous que je dois tout ce que j'ai, et dorénavant je ne l'oublierai plus. »
C'est ainsi que le jeune enfant retira son père de la mauvaise pensée où il s'était laissé entraîner.
Gaston Paris
Note 1 Bernier, l'auteur de ce conte, en vers de huit syllabes, vivait au XIIIe siècle ; il est d'ailleurs inconnu. Le conte vient de l'Inde ; Bernier l'avait recueilli oralement, comme il le dit dans son prologue.
Note 2 Les guerres privées régnaient même entre bourgeois d'une même ville.
Note 3 Les « bourgeois du roi », moyennant l'hommage qu'ils prêtaient et certaines redevances, jouissaient de la protection royale et de nombreux privilèges.
Note 4 On dirait aujourd'hui marchandage ou commerce et non marchandise.
Note 5 Beau sire, sire, dame, beau : appellations courtoises du moyen âge. Il était d'usage, au moyen âge, de se parler, même entre amis et proches parents, en se donnant des titres de politesse. Le mari appelait sa femme dame (ou, plus tendrement sur ) ; la femme appelait son mari sire . Les enfants disaient à leurs parents : sire ou sire père , dame ou dame mère . En parlant à son fils, à son frère, on faisait volontiers précéder les titres de parenté du mot beau , terme d'affection (on ne s'appelait que rarement par son nom). En s'adressant à plusieurs personnes, même de condition égale ou inférieure, on les appelait : seigneurs . Le titre de monseigneur était affecté aux chevaliers, et en les nommant à la troisième personne on faisait précéder leur nom de ce titre ( messire en est une autre forme). En s'adressant à un chevalier ou à un bourgeois on disait : sire ; à un inférieur on disait volontiers : frère et beau sire, beau frère, bel ami . On interpellait un inconnu de la classe guerrière, mais qu'on jugeait de rand modeste, par le mot vassal . On n'appelait par leurs prénoms tout court que les gens de condition tout à fait inférieure ; employer les diminutifs de des prénoms était encore plus familier. Les noms de famille héréditaires n'existaient pas, au moins dans la période ancienne ; ce que nous appelons « prénom » était le nom, auquel on joignait d'ordinaire un surnom, qui pour les nobles était le nom de leur fief, pour les autres le nom de leur lieu d'origine quand ils le quittaient, ou un surnom personnel.
Note 6 Le mot bachelier n'a primitivement que le sens de « jeune homme ». Comme on opposait le bachelier, non encore chevalier, mais aspirant à l'être, au chevalier, on désigna de ce nom ceux qui, dans les diverses Facultés, avaient reçu un premier grade. De là le sens actuel.
Note 7 Deniers, livres : les monnaies mentionnées dans les récits du Moyen-Âge sont le denier, le sou, la livre, le besant, le noble et le marc. La livre valait vingt sous, le sou valait vingt deniers. Le sou était une pièce d'argent dont la valeur intrinsèque était à peu près celle d'un franc du début du vingtième siècle, mais dont le pouvoir était notablement supérieur. Le mot denier, outre son sens propre, se prend au pluriel dans le sens général d' « argent ». Le besant est une monnaie orientale en or, d'une valeur intrinsèque d'environ vingt francs de 1910, mais d'un pouvoir très supérieur. Les nobles, ou nobles à la rose, étaient une monnaie d'or anglaise, qui représentait environ 25 francs de 1910 de valeur intrinsèque, mais, comme toutes les monnaies d'alors, avait un pouvoir plus élevé. Le marc était une monnaie de compte, valant environ une demi-livre. L'épithète d' esterlin ajoutée à une monnaie indique qu'elle est anglaise et qu'elle a un certain titre : c'est le mot anglais sterling.
Note 8 Prisés d'armes, renommés pour leur prouesse.
Note 9 Les tournois n'étaient pas seulement des exercices de force et d'adresse ; c'étaient des jeux d'argent, où on pouvait gagner, mais aussi perdre beaucoup. Le chevalier désarçonné était dépouillé de son cheval et de ses armes, et souvent pris lui-même et mis à rançon.
Note 10 Prud'homme : ce mot désigne, au moyen âge, un homme pourvu de toutes les vertus purement laïques, surtout de sagesse, de prudence et d'intégrité. Il se prend souvent dans un sens assez vague pour désigner en général un homme honorable, considéré.
Note 11 Il arrivait très souvent qu'un homme, au moment de mourir, se faisait recevoir templier, bénédictin (moine noir) ou cistercien (moine blanc), et laissait tout ou partie de ses biens à la communauté dont il avait pris l'habit.
Note 12 Dans le texte original, beau « tayon » (l'ancien mot pour grand-père).
Gaston Paris
Retour au menu
|

Molière
Bouts-rimés, sonnet écrit par Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) avec les rimes que lui fournit le prince de Condé, en guise de jeu poétique ou d'exercice littéraire, publié en 1682.
|
Bouts-rimés
Que vous m'embarrassez avec votre grenouille,
Qui traîne à ses talons le doux mot d'Hypocras !
Je hais des bouts-rimés le puéril fatras,
Et tiens qu'il vaudrait mieux filer une quenouille.
La gloire du bel air n'a rien qui me chatouille ;
Vous m'assommez l'esprit avec un gros plâtras ;
Et je tiens heureux ceux qui sont morts à Coutras,
Voyant tout le papier qu'en sonnets on barbouille.
M'accable derechef la haine du cagot,
Plus méchant mille fois que n'est un vieux magot,
Plutôt qu'un bout-rimé me fasse entrer en danse.
Je vous le chante clair, comme un chardonneret ;
Au bout de l'univers je fuis dans une manse
Adieu, grand Prince, adieu ; tenez-vous guilleret.
Molière
Retour au menu
|

Stephen Leacock
Panique à la banque (titre original : My financial career), nouvelle humoristique de Stephen Leacock (1869-1944), auteur canadien anglophone. Ce texte est extrait des Histoires humoristiques (titre original : Literary lapses), publiées en France par les éditions Robert Laffont seulement en 1963, alors que l'édition originale date de 1910 ! Il est utile de préciser qu'elles furent plutôt déformées que traduites par le très médiocre traducteur Michel Chrestien.
|
Panique à la banque
Dès que j'entre dans une banque, je perds mon sang froid. Les employés me terrorisent ; les guichets me terrorisent ; la vue de l'argent me terrorise, tout me terrorise.
Au moment où je m'approche d'un guichet afin d'essayer d'y effectuer une opération, je deviens l'idiot qui ne répond plus de ses actes.
Malgré tout, mon salaire ayant été porté à cinquante-six mille francs par mois1, je sentais que la banque était le seul endroit sûr pour mettre à l'abri une pareille somme.
Si bien que j'entrai, regardant timidement les employés. Je me dis qu'une personne désireuse de se faire ouvrir un compte devait obligatoirement consulter le directeur.
Je marchai donc au guichet : « Comptable. » Le comptable était un grand diable glacial. Rien que de le voir, j'en eus peur. Ma voix devint sépulcrale :
« Puis-je voir le directeur ? » demandai-je. Et j'ajoutai, solennel : « Seul . »
Je ne sais pas pourquoi je dis : Seul .
« Certainement », dit le comptable, et il alla le chercher. Le directeur était un homme grave et calme. Je tenais les cinquante-six mille anciens francs de mon salaire mensuel roulés en boule au fond de ma poche.
« Etes-vous le directeur ? demandai-je. (Dieu sait que je n'en doutais pas.)
Oui, me dit-il
Puis-je vous voir, lui demandai-je, seul ? (De nouveau, je ne voulais pas dire « seul », mais je ne sais quel diable me poussait.)
Le directeur me regarda quelque peu inquiet. Il pensa que j'avais un terrible secret à lui confier.
« Entrez ici », me dit-il, et il me conduisit dans son bureau. Il ferma la porte à clef :
« Comme ça, nous ne serons pas dérangés, dit-il, asseyez-vous. »
Tous deux, nous nous assîmes. Je n'avais pas de voix pour parler.
« Vous êtes un homme du quai des Orfèvres2, je présume ? » dit-il.
Il avait déduit de mes façons mystérieuses que j'étais un inspecteur de police. Tout cela ne fit qu'aggraver mon état.
« Non, pas du quai des Orfèvres, dis-je, semblant indiquer par là que si je faisais de la police, c'était à titre privé.
Pour vous dire la vérité, ajoutai-je (comme si on m'avait poussé à mentir), je ne suis pas détective du tout, je suis venu ouvrir un compte. J'ai l'intention de déposer tout mon argent dans votre banque. »
Le directeur parut soulagé, mais il resta grave. Il avait certainement dans l'idée que j'étais le fils du baron de Rothschild ou le futur gendre d'Onassis3.
« Un compte important, je suppose ?
Assez important, murmurai-je. J'ai l'intention de déposer cinquante-six mille anciens francs aujourd'hui et cinquante mille francs régulièrement tous les mois. »
Le directeur se leva et ouvrit la porte. Il appela le comptable :
« Monsieur Durlot4, cria-t-il regrettablement fort, ce gentleman ouvre un compte chez nous, il va déposer cinq cent soixante nouveaux francs. Bonsoir, monsieur !
»
Je me levai.
Une grande porte de fer était ouverte d'un côté du bureau.
« Bonsoir, dis-je, et je pénétrai dans le coffre-fort.
Sortez », dit le directeur, froid, et il me montra l'autre porte.
Je gagnai le guichet du comptable à qui je tendis ma boule de billets d'un mouvement convulsif et rapide, tel un prestidigitateur5.
Mon visage était d'une pâleur spectrale.
« Voilà, lui dis-je, inscrivez ça à mon compte. » Mon ton semblait signifier : accomplissons cet acte pénible avant que la fièvre tombe.
Il prit l'argent qu'il tendit à un autre employé.
Il me fit noter la somme sur un morceau de papier et signer de mon nom dans un registre. Je ne savais plus ce que j'étais en train de faire. La banque flottait autour de moi.
« C'est déposé ? demandai-je d'une voix creuse et qui vibrait.
Oui, répondit le comptable.
Alors, je voudrais tirer un chèque. »
Mon intention était de prendre six mille anciens francs pour mon usage immédiat. Quelqu'un me tendit un carnet à travers un guichet et quelqu'un d'autre se mit à m'expliquer comment il fallait remplir le chèque. Les gens de la banque avaient l'impression que j'étais un millionnaire un peu diminué. J'écrivis quelque chose sur le chèque que je tendis à l'employé. Il regarda.
« Quoi ! vous retirez tout ? » demanda-t-il, surpris.
Je me rendis compte alors que j'avais écrit cinquante-six mille au lieu de six mille. Mais les choses étaient allées trop loin pour me permettre de revenir sur mes pas. J'eus l'impression qu'il me serait impossible de m'expliquer. Tous les employés s'étaient arrêtés d'écrire, ils me regardaient.
Téméraire et angoissé, je me jetai à l'eau.
« Oui, la somme entière.
Vous retirez votre argent de la banque ?
Jusqu'au dernier centime.
Est-ce que vous n'allez plus en déposer ? demanda l'employé frappé de stupeur.
Plus jamais. »
L'espoir idiot m'envahit qu'ils pourraient croire que quelque chose m'avait froissé pendant que je remplissait mon chèque et m'avait fait changer d'avis. J'essayai sans beaucoup de succès de jouer le monsieur au caractère très emporté.
Impavide, l'employé se mit en devoir de me payer l'argent.
« Comment les voulez-vous ? demanda-t-il.
Oh !
» fis-je. Et comme il continuait de me regarder avec insistance je répondis sans même essayer de penser :
« En billets de cinquante. »
Il me donna un seul billet de cinquante mille anciens francs.
« Et les six mille anciens francs ? demanda-t-il sèchement.
Faites pour le mieux », dis-je.
Il me donna six billets de mille et je bondis hors de cet endroit inhospitalier. 6
Depuis, je ne banque plus, je garde mon argent en monnaie dans la poche de mon pantalon, et mes économies, en pièces de cinq nouveaux francs7 dans une chaussette.
Stephen Leacock (Trahis plus que traduis par Michel Chrestien. En réparation de cette traduction désastreuse, voir juste après les notes ci-dessous, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, la version originale du texte dans son intégralité.)
Note 1 Dans la version originale la somme mentionnée est de « fifty dollars a month », cinquante dollars canadiens de l'époque par mois.
Note 2 Dans la version originale il est dit : « You are one of Pinkerton's men, I presume », vous êtes l'un des hommes de Pinkerton, je présume. Référence à une célèbre agence de détectives américaine : Pinkerton National Detective Agency .
Note 3 Cette piteuse traduction est une déformation perpétuelle du texte originel. Dans la version originale, on peut lire : « I was a son of Baron Rothschild or a young Gould » Jay Gould (1836-1892) fut un magnat des chemins de fer des Etats-Unis, ses héritiers furent immensément riches.
Note 4 Mr. Montgomery dans la version originale. Le traducteur a tellement tenu à donner un ton franchouillard à l'histoire qu'il change absolument tout à sa guise.
Note 5 Dans la version originale il est écrit « with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. », avec un mouvement convulsif rapide comme si je faisais un tour de passe-passe. Décidément le traducteur était très pressé d'avoir son argent, quitte à bâcler son travail.
Note 6 Ici, une phrase de la version originale est purement et simplement supprimée au lieu de traduite : « As the big door swung behind me I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. » Voici ce que l'on devrait lire dans la version française si le traducteur avait bien fait son travail : Comme la grande porte se balançait derrière moi j'entendis l'écho d'un hurlement de rire monter jusqu'au plafond de la banque.
Note 7 Dans la version originale il est question de « silver dollars », de grosses pièces d'argent de un dollar américain (les pièces de un dollar en argent ne furent courantes au Canada qu'à partir de 1935, or l'histoire date de 1910, l'auteur s'adresse donc à un lectorat nord-américain plutôt que canadien).
En réparation de cette traduction désastreuse, voici ci-dessous, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, la version originale du texte dans son intégralité.
My financial career
When I go into a bank I get rattled. The clerks rattle me ; the wickets rattle me ; the sight of the money rattles me ; everything rattles me.
The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot.
I knew this beforehand, but my salary had been raised to fifty dollars a month and I felt that the bank was the only place for it.
So I shambled in and looked timidly round at the clerks. I had an idea that a person about to open an account must needs consult the manager.
I went up to a wicket marked "Accountant." The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him rattled me. My voice was sepulchral.
"Can I see the manager ? " I said, and added solemnly,
"alone." I don't know why I said "alone."
"Certainly," said the accountant, and fetched him.
The manager was a grave, calm man. I held my fifty-six dollars clutched in a crumpled ball in my pocket.
"Are you the manager ? " I said. God knows I didn't doubt it.
"Yes," he said.
"Can I see you," I asked, "alone ? " I didn't want to say "alone" again, but without it the thing seemed self-evident.
The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. "Come in here," he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock.
"We are safe from interruption here," he said ; "sit down."
We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak.
"You are one of Pinkerton's men, I presume," he said.
He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse.
"No, not from Pinkerton's," I said, seeming to imply that I came from a rival agency.
"To tell the truth," I went on, as if I had been prompted to lie about it, "I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank."
The manager looked relieved but still serious ; he concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gould.
"A large account, I suppose," he said.
"Fairly large," I whispered. "I propose to deposit fifty-six dollars now and fifty dollars a month regularly."
The manager got up and opened the door. He called to the accountant.
"Mr. Montgomery," he said unkindly loud, "this gentleman is opening an account, he will deposit fifty-six dollars. Good morning."
I rose.
A big iron door stood open at the side of the room.
"Good morning," I said, and stepped into the safe.
"Come out," said the manager coldly, and showed me the other way.
I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick.
My face was ghastly pale.
"Here," I said, "deposit it." The tone of the words seemed to mean, "Let us do this painful thing while the fit is on us."
He took the money and gave it to another clerk.
He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes.
"Is it deposited ? " I asked in a hollow, vibrating voice.
"It is," said the accountant.
"Then I want to draw a cheque."
My idea was to draw out six dollars of it for present use. Someone gave me a chequebook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. I wrote something on the cheque and thrust it in at the clerk. He looked at it.
"What ! are you drawing it all out again ? " he asked in surprise. Then I realized that I had written fifty-six instead of six. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me.
Reckless with misery, I made a plunge.
"Yes, the whole thing."
"You withdraw your money from the bank ? "
"Every cent of it."
"Are you not going to deposit any more ? " said the clerk, astonished.
"Never."
An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the cheque and that I had changed my mind. I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper.
The clerk prepared to pay the money.
"How will you have it ? " he said.
"What ? "
"How will you have it ? "
"Oh" I caught his meaning and answered without even trying to think "in fifties."
He gave me a fifty-dollar bill.
"And the six ? " he asked dryly.
"In sixes," I said.
He gave it me and I rushed out.
As the big door swung behind me I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock.
Stephen Leacock
Retour au menu
|

Guy de Maupassant
Sur l'eau, conte fantastique de Guy de Maupassant (1850-1893), publié pour la première fois en 1876 sous le titre En canot. Ce texte est extrait du recueil de nouvelles La maison Tellier, paru en 1881.
|
Sur l'eau
J'avais loué, l'été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d'un de mes voisins, un homme de trente à quarante ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final.
Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible : la rivière.
« Ah ! me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous ! Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit, la nuit, des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière : et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau.
« La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante c'est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer ; tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'Océan.
« Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d'immenses pays bleuâtres, où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d'étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n'a que des profondeurs noires où l'on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu'elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent.
« Le poète a dit en parlant de l'Océan :
Ô flots, que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds, redoutés des mères à genoux,
Vous vous les racontez en montant les marées
Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez, le soir, quand vous venez vers nous.
« Eh bien, je crois que les histoires chuchotées par les roseaux minces avec leurs petites voix si douces doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues.
« Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici, il y a une dizaine d'années.
« J'habitais comme aujourd'hui la maison de la mère Lafon, et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui a maintenant renoncé au canotage, à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'Etat, était installé au village de C..., deux lieues plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi.
« Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de douze pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine auprès de la pointe des roseaux, là-bas, deux cents mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique ; la lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta ; je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée ; je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière.
« Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta ; et je m'assis à l'arrière sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien, rien : parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter.
« Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages, se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille coassa. Je tressaillis : elle se tut ; je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipes renommé, je ne pus pas ; dès la seconde bouffée, le cur me tourna et je cessai. Je me mis à chantonner ; le son de ma voix m'était pénible ; alors, je m'étendis au fond du bateau et je regardai le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve ; puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête ; j'entendis des bruits autour de moi ; je me dressai d'un bond : l'eau brillait, tout était calme.
« Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne ; le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance, je tirai plus fort, l'ancre ne vint pas ; elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever ; je recommençai à tirer, mais inutilement.
« Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je le portai en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain, elle tenait toujours ; je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis découragé et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras ; mais comme le temps demeurait fort beau, je pensai que je ne tarderais point, sans doute, à rencontrer quelque pêcheur qui viendrait à mon secours. Ma mésaventure m'avait calmé ; je m'assis et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédais une bouteille de rhum, j'en bus deux ou trois verres, et ma situation me fit rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur je pouvais, sans grand mal, passer la nuit à la belle étoile.
« Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Je fis un soubresaut, et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelque bout de bois entraîné par le courant, mais cela avait suffi et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Je saisis ma chaîne et je me raidis dans un effort désespéré. L'ancre tint bon. Je me rassis épuisé.
« Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible, j'avais les tempes serrées, mon cur battait à m'étouffer ; et, perdant la tête, je pensai à me sauver à la nage ; puis aussitôt cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis, perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire.
« En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant au moins pendant cinq cents mètres avant de trouver un point libre d'herbes et de joncs où je pusse prendre pied, il y avait pour moi neuf chances sur dix de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse.
« J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma volonté, et cette autre chose avait peur. Je me demandai ce que je pouvais redouter ; mon moi brave railla mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour.
« Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue et attendant. Quoi ? Je n'en savais rien, mais ce devait être terrible. Je crois que si un poisson se fût avisé de sauter hors de l'eau, comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber raide, sans connaissance.
« Cependant, par un effort violent, je finis par ressaisir à peu près ma raison qui m'échappait. Je pris de nouveau ma bouteille de rhum et je bus à grands traits. Alors une idée me vint et je me mis à crier de toutes mes forces en me tournant successivement vers les quatre points de l'horizon. Lorsque mon gosier fut absolument paralysé, j'écoutai. Un chien hurlait, très loin.
« Je bus encore et je m'étendis tout de mon long au fond du bateau. Je restai ainsi peut-être une heure, peut-être deux, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi. Je n'osais pas me lever et pourtant je le désirais violemment ; je remettais de minute en minute. Je me disais : « Allons, debout ! » et j'avais peur de faire un mouvement. A la fin, je me soulevai avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardai par-dessus le bord.
« Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans les croire.
« Le brouillard qui, deux heures auparavant, flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives. Laissant le fleuve absolument libre, il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de six ou sept mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges. De sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette rivière lamée de feu entre ces deux montagnes blanches ; et là-haut, sur ma tête, s'étalait, pleine et large, une grande lune illuminante au milieu d'un ciel bleuâtre et laiteux.
« Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées ; les grenouilles coassaient furieusement, tandis que, d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste, que jette aux étoiles la voix cuivrée des crapauds. Chose étrange, je n'avais plus peur ; j'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner.
« Combien de temps cela dura-t-il, je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages. L'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde.
« Je bus ce qui me restait de rhum, puis j'écoutai en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchai à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau, ni mes mains elles-mêmes, que j'approchais de mes yeux.
« Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Soudain je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi ; je poussai un cri, une voix répondit ; c'était un pêcheur. Je l'appelai, il s'approcha et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien, et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'ancre ne remua pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial, une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre barque, nous la hélâmes. L'homme qui la montait unit ses efforts aux nôtres ; alors, peu à peu, l'ancre céda. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids considérable. Enfin nous aperçûmes une masse noire, et nous la tirâmes à mon bord :
« C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. »
Guy de Maupassant
Retour au menu
|
|
|
|
|